 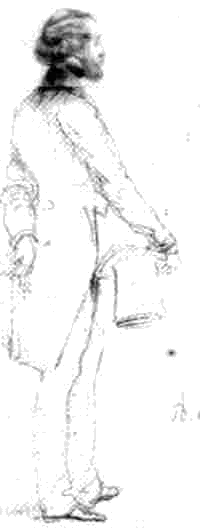 Si
vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir Les Enfants du Siècle, le film
de Diane Kurys qui raconte la liaison entre Alfred de Musset et George Sand.
Déjà, parce qu'il est globalement juste et très bien interprété, et ensuite
parce que les amis de la poésie ne peuvent manquer de voir un film où apparaît
Alfred de Musset - je vous demande de me pardonner cette injonction. Je
veux simplement ici faire quelques commentaires concernant, d'une part,
les deux personnages, tels qu'a voulu nous les montrer la réalisatrice,
et d'autre part, les approximations et omissions volontaires qui ont hélas
simplifié la réalité des choses. Un film n'est cependant pas un documentaire
me direz-vous, ce dont je conviens volontiers, mais dans le cas présent
les choses ont été autrement plus étonnantes et riches que ce que nous laisse
croire Diane Kurys. Dans mon esprit, les lignes qui suivent ne constituent
pas une critique négative de ce film qui m'a emporté de la première minute
à la dernière. Je comprends d'ailleurs que des exigences liées au scénario
puissent m'échapper. Cependant, je voudrais saisir le prétexte qui se présente
pour écrire quelques lignes sur ce qui est effectivement une des histoires
amoureuses et poétiques les plus étincelantes. Je voudrais écrire ici quelques
lignes du scénario d'un documentaire imaginaire qui permettront peut-être,
à ceux qui ont vu le film, de mieux en comprendre les non-dits et les allusions,
et à ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller le voir avec un regard "averti".
Commençons par la rencontre. George Sand et Alfred de Musset ne se voient
pas pour la première fois dans un vague cocktail mais autour d'une table,
au cours d'un repas organisé par Buloz, le directeur de la Revue des deux
Mondes - personnage d'ailleurs très justement rendu dans le film. Détail
symbolique et émouvant, Sand et Musset sont voisins parce que Sand est la
seule femme de l'assemblée et parce que Musset, alors âgé de 22 ans, est
le plus jeune. Si, par hasard, vous passez un 17 juin au 104 de la rue Richelieu,
pensez à eux. C'était l'année 1833, celle de la rencontre entre Juliette
Drouet et son "Toto adoré", mais les années ne m'intéressent pas. Leur liaison
naît au milieu d'une fête populaire, dans les tous derniers jours du mois
de juillet, pour le troisième anniversaire de la Révolution de Juillet.
J'ai regretté de ne pas voir quelques feux d'artifices et de ne pas entendre
ces vers que Musset écrit à Georges Sand le jeudi 2 août, au soir : "Te
voilà revenu dans mes nuits étoilées, Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières
voilées, Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu..." C'est effectivement
à Fontainebleau, début août, que les deux amants cèlent plus fermement leur
union. Le décor de grands rochers gréseux - avec coucher de soleil - ainsi
que les promenades à cheval y font subtilement allusion. Deux choses manquent
cependant ici. Deux choses qui auraient sans doute montré George Sand plus
proche de la réalité : d'une part, elle doit annuler une première escapade
avec un italien de ses amants pour partir une semaine avec Musset, et d'autre
part, elle est tantôt amazone tantôt homme au cours de ce séjour. Si George
Sand est indéniablement amoureuse de Musset, elle dévore quantité d'hommes
partout où elle passe : avant, pendant, après Musset, elle a des amants
nombreux. Diane Kurys nous présente Musset quittant la chaleur d'une maison
close pour aller se recueillir aussitôt dans les bras de George Sand quand
ses " hésitations " à elles sont fâcheusement oubliées. Or, George Sand
n'est à aucun moment la victime de Musset, que ce soit à Paris ou à Venise.
George Sand est certes sensible et douce mais elle est une femme de caractère.
Elle est forte maîtresse. Quant à l'ambiguité sexuelle de George Sand, qui
est un élement essentiel de sa vie, l'est également dans sa relation avec
Musset : ne la nomme-t-il pas, dans la plupart de ses lettres : "Mon George"...
Le départ pour Venise est très justement rendu, notamment l'entrevue qui
réunit George Sand et la mère de Musset. Il est exact que George Sand promet
à cette femme de s'occuper de son fils et de le protéger. D'ailleurs, elle
rappelle souvent à Musset qu'elle l'aime comme son enfant ; quant à lui,
par une heureuse réciprocité, il lui dit fréquemment qu'il l'aime comme
une mère. Si d'aventure vous passez un 12 décembre devant le 59 de la rue
de Grenelle, pensez à eux. La dernière lettre de Verlaine à Rimbaud est
datée d'un 12 décembre - 1875, mais les années ne m'intéressent pas ; c'est
également un 12 décembre que Jean Cassou est mis au secret - en 1941, mais
les années... Ne cherchez pas forcément de points communs entre ces évènements
car il ne semble pas y en avoir. Seul notre bon vieux Max, grand connaisseur
et magicien des dates, aurait su découvrir d'éventuels rapprochements. Mais
Max n'est plus, tout comme George, Alfred et les autres. Pensez à eux. Arrivés
à Lyon, les deux amants descendent le Rhône en compagnie de Stendhal. Diane
Kurys s'en passe et elle a bien raison car il n'a pas d'importance. L'arrivée
à Venise est juste mais le reste du séjour l'est déjà moins, notamment cette
surprenante prise d'opium. Musset touche certainement çà et là à l'opium,
mais à Venise, sa crise de délire et de fièvre a une cause bien différente
: tout au long de sa vie, il est effectivement la victime de crises de démences
dûes semble-t-il à une syphillis contractée précocément, à l'adolescence.
Car ce film nous le fait bien comprendre, Musset est un grand amateur de
maisons closes, dans lesquelles il va d'ailleurs toujours "en équipe", avec
le critique et néanmoins attentionné Sainte-Beuve par exemple, qu'il a initié
lui-même à ces plaisirs un 2 janvier. Ces crises ont une place capitale
dans la vie de Musset. Il en souffre beaucoup. Dans ce contexte, la venue
de l'opium me semble bien inexplicable. Cet artifice mis de côté, la veille
de George auprès de Musset est émouvante et juste. Rien à dire sur le docteur
Pagello : il est docteur et italien ! Cependant, je reste rêveur lorsque
Diane Kurys nous présente innocemment George Sand être la victime de Pagello
- après qu'elle a d'ailleurs été la victime du léger Musset. D'une part,
Musset n'est pas responsable de sa crise de démence, et d'autre part, George
Sand obtient le docteur Pagello parce qu'elle le veut. Quant au départ de
Musset pour Paris, la réalisatrice nous en offre une version à mon sens
un peu trop tendre. Elle oublie les injures : " Tu es bon à enfermer dans
un asile ", dit George à Musset qui répond par " sale putain ". Elle oublie
également les poursuites - poignard à la main - dans le cimetière juif de
l'îlot Saint-Blaise. Diane Kurys les veut toujours tendres et doux. Ils
sont parfois violents. En attendant le retour de George, au printemps 1834,
Musset écrit " On ne badine pas avec l'amour " qui est publié en juillet
suivant. Lisez et relisez ce chef d'œuvre, et pensez à eux. George rentre
le 14 août. Ils se revoient le 17. C'est là que vient un détail essentiel
qui a hélas été évité par la réalisatrice : le 19, Musset demande à George
de la rencontrer au Père-Lachaise, sur la tombe de son père. Tel est par
moment le romantisme de Musset, passionnément macabre. Les cendres de feu
son père échappent cependant à leur visite. Viennent ensuite des retrouvailles
et des séparations sans fin : ils se séparent le 23 août, se revoient le
20 octobre, rompent le 9 novembre - grande date que ce 9 novembre ! C'est
à ce moment précis que viennent les cheveux coupés : dans le film, ils prennent
tout au plus la forme d'une anecdote dont on ne comprend pas bien le sens,
alors qu'ils ont en réalité la dimension d'une des plus grandes légendes
romantiques. Ils sont les cheveux coupés que l'histoire du romantisme devrait
retenir, comme elle retient Jakob Michael Lenz tombant à genoux et pleurant
d'extase sur les bords du Rhin. George fait plus que se couper les cheveux
: elle se les tond puis les envoie, protégés dans la cage cervicale d'un
crâne humain, à son amant. Tel est le romantisme de George qui émeut d'ailleurs
fugitivement Musset : ils se raccomodent trois jours puis se séparent à
nouveau. Ils se retrouvent le 2 janvier suivant (" je ne t'aime plus mais
je t'adore toujours " lui écrit-elle alors) et assistent à une représentation
de Chatterton à la Comédie française, le 14 février. Musset ressort un poignard
le 22 février - jour de l'arrestation de notre bon vieux Max, mais cela
est sans aucun rapport - puis ils se voient pour la dernière fois le 6 mars
- c'est à dire le jour où Ronsard est tonsuré mais cela n'a encore aucun
rapport. Les derniers mots de la dernière lettre de George à Musset sont
" Adieu mon enfant, que Dieu soit avec toi ". A l'avenir, toutes sortes
de gens, de plaisirs et d'abus entoureront Musset, et peut-être même Dieu,
un Dieu de passage alors, mais plus jamais George Sand. Il ne se reverront
plus. La fin du film est d'une consistance étrange. Leur amour y est faussement
romancé. Lorsque Musset décède, plus de vingt ans après, au 6 de la rue
du Mont Thabor, un 2 mai - de l'année 1857, mais vous n'ignorez plus que
les années m'indiffèrent - George Sand est loin de lui, et même très loin.
George Sand ne fait pas partie des trente ombres du cortège. Pensez à eux.
Pensez à elle. Pensez à lui. Il faut croire qu'on ne se coupe les cheveux
qu'une seule fois dans sa vie. Si
vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir Les Enfants du Siècle, le film
de Diane Kurys qui raconte la liaison entre Alfred de Musset et George Sand.
Déjà, parce qu'il est globalement juste et très bien interprété, et ensuite
parce que les amis de la poésie ne peuvent manquer de voir un film où apparaît
Alfred de Musset - je vous demande de me pardonner cette injonction. Je
veux simplement ici faire quelques commentaires concernant, d'une part,
les deux personnages, tels qu'a voulu nous les montrer la réalisatrice,
et d'autre part, les approximations et omissions volontaires qui ont hélas
simplifié la réalité des choses. Un film n'est cependant pas un documentaire
me direz-vous, ce dont je conviens volontiers, mais dans le cas présent
les choses ont été autrement plus étonnantes et riches que ce que nous laisse
croire Diane Kurys. Dans mon esprit, les lignes qui suivent ne constituent
pas une critique négative de ce film qui m'a emporté de la première minute
à la dernière. Je comprends d'ailleurs que des exigences liées au scénario
puissent m'échapper. Cependant, je voudrais saisir le prétexte qui se présente
pour écrire quelques lignes sur ce qui est effectivement une des histoires
amoureuses et poétiques les plus étincelantes. Je voudrais écrire ici quelques
lignes du scénario d'un documentaire imaginaire qui permettront peut-être,
à ceux qui ont vu le film, de mieux en comprendre les non-dits et les allusions,
et à ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller le voir avec un regard "averti".
Commençons par la rencontre. George Sand et Alfred de Musset ne se voient
pas pour la première fois dans un vague cocktail mais autour d'une table,
au cours d'un repas organisé par Buloz, le directeur de la Revue des deux
Mondes - personnage d'ailleurs très justement rendu dans le film. Détail
symbolique et émouvant, Sand et Musset sont voisins parce que Sand est la
seule femme de l'assemblée et parce que Musset, alors âgé de 22 ans, est
le plus jeune. Si, par hasard, vous passez un 17 juin au 104 de la rue Richelieu,
pensez à eux. C'était l'année 1833, celle de la rencontre entre Juliette
Drouet et son "Toto adoré", mais les années ne m'intéressent pas. Leur liaison
naît au milieu d'une fête populaire, dans les tous derniers jours du mois
de juillet, pour le troisième anniversaire de la Révolution de Juillet.
J'ai regretté de ne pas voir quelques feux d'artifices et de ne pas entendre
ces vers que Musset écrit à Georges Sand le jeudi 2 août, au soir : "Te
voilà revenu dans mes nuits étoilées, Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières
voilées, Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu..." C'est effectivement
à Fontainebleau, début août, que les deux amants cèlent plus fermement leur
union. Le décor de grands rochers gréseux - avec coucher de soleil - ainsi
que les promenades à cheval y font subtilement allusion. Deux choses manquent
cependant ici. Deux choses qui auraient sans doute montré George Sand plus
proche de la réalité : d'une part, elle doit annuler une première escapade
avec un italien de ses amants pour partir une semaine avec Musset, et d'autre
part, elle est tantôt amazone tantôt homme au cours de ce séjour. Si George
Sand est indéniablement amoureuse de Musset, elle dévore quantité d'hommes
partout où elle passe : avant, pendant, après Musset, elle a des amants
nombreux. Diane Kurys nous présente Musset quittant la chaleur d'une maison
close pour aller se recueillir aussitôt dans les bras de George Sand quand
ses " hésitations " à elles sont fâcheusement oubliées. Or, George Sand
n'est à aucun moment la victime de Musset, que ce soit à Paris ou à Venise.
George Sand est certes sensible et douce mais elle est une femme de caractère.
Elle est forte maîtresse. Quant à l'ambiguité sexuelle de George Sand, qui
est un élement essentiel de sa vie, l'est également dans sa relation avec
Musset : ne la nomme-t-il pas, dans la plupart de ses lettres : "Mon George"...
Le départ pour Venise est très justement rendu, notamment l'entrevue qui
réunit George Sand et la mère de Musset. Il est exact que George Sand promet
à cette femme de s'occuper de son fils et de le protéger. D'ailleurs, elle
rappelle souvent à Musset qu'elle l'aime comme son enfant ; quant à lui,
par une heureuse réciprocité, il lui dit fréquemment qu'il l'aime comme
une mère. Si d'aventure vous passez un 12 décembre devant le 59 de la rue
de Grenelle, pensez à eux. La dernière lettre de Verlaine à Rimbaud est
datée d'un 12 décembre - 1875, mais les années ne m'intéressent pas ; c'est
également un 12 décembre que Jean Cassou est mis au secret - en 1941, mais
les années... Ne cherchez pas forcément de points communs entre ces évènements
car il ne semble pas y en avoir. Seul notre bon vieux Max, grand connaisseur
et magicien des dates, aurait su découvrir d'éventuels rapprochements. Mais
Max n'est plus, tout comme George, Alfred et les autres. Pensez à eux. Arrivés
à Lyon, les deux amants descendent le Rhône en compagnie de Stendhal. Diane
Kurys s'en passe et elle a bien raison car il n'a pas d'importance. L'arrivée
à Venise est juste mais le reste du séjour l'est déjà moins, notamment cette
surprenante prise d'opium. Musset touche certainement çà et là à l'opium,
mais à Venise, sa crise de délire et de fièvre a une cause bien différente
: tout au long de sa vie, il est effectivement la victime de crises de démences
dûes semble-t-il à une syphillis contractée précocément, à l'adolescence.
Car ce film nous le fait bien comprendre, Musset est un grand amateur de
maisons closes, dans lesquelles il va d'ailleurs toujours "en équipe", avec
le critique et néanmoins attentionné Sainte-Beuve par exemple, qu'il a initié
lui-même à ces plaisirs un 2 janvier. Ces crises ont une place capitale
dans la vie de Musset. Il en souffre beaucoup. Dans ce contexte, la venue
de l'opium me semble bien inexplicable. Cet artifice mis de côté, la veille
de George auprès de Musset est émouvante et juste. Rien à dire sur le docteur
Pagello : il est docteur et italien ! Cependant, je reste rêveur lorsque
Diane Kurys nous présente innocemment George Sand être la victime de Pagello
- après qu'elle a d'ailleurs été la victime du léger Musset. D'une part,
Musset n'est pas responsable de sa crise de démence, et d'autre part, George
Sand obtient le docteur Pagello parce qu'elle le veut. Quant au départ de
Musset pour Paris, la réalisatrice nous en offre une version à mon sens
un peu trop tendre. Elle oublie les injures : " Tu es bon à enfermer dans
un asile ", dit George à Musset qui répond par " sale putain ". Elle oublie
également les poursuites - poignard à la main - dans le cimetière juif de
l'îlot Saint-Blaise. Diane Kurys les veut toujours tendres et doux. Ils
sont parfois violents. En attendant le retour de George, au printemps 1834,
Musset écrit " On ne badine pas avec l'amour " qui est publié en juillet
suivant. Lisez et relisez ce chef d'œuvre, et pensez à eux. George rentre
le 14 août. Ils se revoient le 17. C'est là que vient un détail essentiel
qui a hélas été évité par la réalisatrice : le 19, Musset demande à George
de la rencontrer au Père-Lachaise, sur la tombe de son père. Tel est par
moment le romantisme de Musset, passionnément macabre. Les cendres de feu
son père échappent cependant à leur visite. Viennent ensuite des retrouvailles
et des séparations sans fin : ils se séparent le 23 août, se revoient le
20 octobre, rompent le 9 novembre - grande date que ce 9 novembre ! C'est
à ce moment précis que viennent les cheveux coupés : dans le film, ils prennent
tout au plus la forme d'une anecdote dont on ne comprend pas bien le sens,
alors qu'ils ont en réalité la dimension d'une des plus grandes légendes
romantiques. Ils sont les cheveux coupés que l'histoire du romantisme devrait
retenir, comme elle retient Jakob Michael Lenz tombant à genoux et pleurant
d'extase sur les bords du Rhin. George fait plus que se couper les cheveux
: elle se les tond puis les envoie, protégés dans la cage cervicale d'un
crâne humain, à son amant. Tel est le romantisme de George qui émeut d'ailleurs
fugitivement Musset : ils se raccomodent trois jours puis se séparent à
nouveau. Ils se retrouvent le 2 janvier suivant (" je ne t'aime plus mais
je t'adore toujours " lui écrit-elle alors) et assistent à une représentation
de Chatterton à la Comédie française, le 14 février. Musset ressort un poignard
le 22 février - jour de l'arrestation de notre bon vieux Max, mais cela
est sans aucun rapport - puis ils se voient pour la dernière fois le 6 mars
- c'est à dire le jour où Ronsard est tonsuré mais cela n'a encore aucun
rapport. Les derniers mots de la dernière lettre de George à Musset sont
" Adieu mon enfant, que Dieu soit avec toi ". A l'avenir, toutes sortes
de gens, de plaisirs et d'abus entoureront Musset, et peut-être même Dieu,
un Dieu de passage alors, mais plus jamais George Sand. Il ne se reverront
plus. La fin du film est d'une consistance étrange. Leur amour y est faussement
romancé. Lorsque Musset décède, plus de vingt ans après, au 6 de la rue
du Mont Thabor, un 2 mai - de l'année 1857, mais vous n'ignorez plus que
les années m'indiffèrent - George Sand est loin de lui, et même très loin.
George Sand ne fait pas partie des trente ombres du cortège. Pensez à eux.
Pensez à elle. Pensez à lui. Il faut croire qu'on ne se coupe les cheveux
qu'une seule fois dans sa vie. |

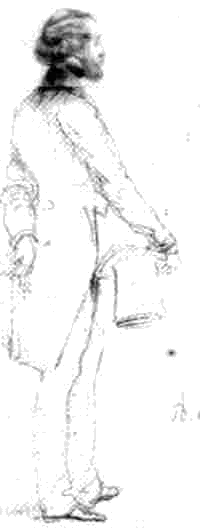 Si
vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir Les Enfants du Siècle, le film
de Diane Kurys qui raconte la liaison entre Alfred de Musset et George Sand.
Déjà, parce qu'il est globalement juste et très bien interprété, et ensuite
parce que les amis de la poésie ne peuvent manquer de voir un film où apparaît
Alfred de Musset - je vous demande de me pardonner cette injonction. Je
veux simplement ici faire quelques commentaires concernant, d'une part,
les deux personnages, tels qu'a voulu nous les montrer la réalisatrice,
et d'autre part, les approximations et omissions volontaires qui ont hélas
simplifié la réalité des choses. Un film n'est cependant pas un documentaire
me direz-vous, ce dont je conviens volontiers, mais dans le cas présent
les choses ont été autrement plus étonnantes et riches que ce que nous laisse
croire Diane Kurys. Dans mon esprit, les lignes qui suivent ne constituent
pas une critique négative de ce film qui m'a emporté de la première minute
à la dernière. Je comprends d'ailleurs que des exigences liées au scénario
puissent m'échapper. Cependant, je voudrais saisir le prétexte qui se présente
pour écrire quelques lignes sur ce qui est effectivement une des histoires
amoureuses et poétiques les plus étincelantes. Je voudrais écrire ici quelques
lignes du scénario d'un documentaire imaginaire qui permettront peut-être,
à ceux qui ont vu le film, de mieux en comprendre les non-dits et les allusions,
et à ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller le voir avec un regard "averti".
Commençons par la rencontre. George Sand et Alfred de Musset ne se voient
pas pour la première fois dans un vague cocktail mais autour d'une table,
au cours d'un repas organisé par Buloz, le directeur de la Revue des deux
Mondes - personnage d'ailleurs très justement rendu dans le film. Détail
symbolique et émouvant, Sand et Musset sont voisins parce que Sand est la
seule femme de l'assemblée et parce que Musset, alors âgé de 22 ans, est
le plus jeune. Si, par hasard, vous passez un 17 juin au 104 de la rue Richelieu,
pensez à eux. C'était l'année 1833, celle de la rencontre entre Juliette
Drouet et son "Toto adoré", mais les années ne m'intéressent pas. Leur liaison
naît au milieu d'une fête populaire, dans les tous derniers jours du mois
de juillet, pour le troisième anniversaire de la Révolution de Juillet.
J'ai regretté de ne pas voir quelques feux d'artifices et de ne pas entendre
ces vers que Musset écrit à Georges Sand le jeudi 2 août, au soir : "Te
voilà revenu dans mes nuits étoilées, Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières
voilées, Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu..." C'est effectivement
à Fontainebleau, début août, que les deux amants cèlent plus fermement leur
union. Le décor de grands rochers gréseux - avec coucher de soleil - ainsi
que les promenades à cheval y font subtilement allusion. Deux choses manquent
cependant ici. Deux choses qui auraient sans doute montré George Sand plus
proche de la réalité : d'une part, elle doit annuler une première escapade
avec un italien de ses amants pour partir une semaine avec Musset, et d'autre
part, elle est tantôt amazone tantôt homme au cours de ce séjour. Si George
Sand est indéniablement amoureuse de Musset, elle dévore quantité d'hommes
partout où elle passe : avant, pendant, après Musset, elle a des amants
nombreux. Diane Kurys nous présente Musset quittant la chaleur d'une maison
close pour aller se recueillir aussitôt dans les bras de George Sand quand
ses " hésitations " à elles sont fâcheusement oubliées. Or, George Sand
n'est à aucun moment la victime de Musset, que ce soit à Paris ou à Venise.
George Sand est certes sensible et douce mais elle est une femme de caractère.
Elle est forte maîtresse. Quant à l'ambiguité sexuelle de George Sand, qui
est un élement essentiel de sa vie, l'est également dans sa relation avec
Musset : ne la nomme-t-il pas, dans la plupart de ses lettres : "Mon George"...
Le départ pour Venise est très justement rendu, notamment l'entrevue qui
réunit George Sand et la mère de Musset. Il est exact que George Sand promet
à cette femme de s'occuper de son fils et de le protéger. D'ailleurs, elle
rappelle souvent à Musset qu'elle l'aime comme son enfant ; quant à lui,
par une heureuse réciprocité, il lui dit fréquemment qu'il l'aime comme
une mère. Si d'aventure vous passez un 12 décembre devant le 59 de la rue
de Grenelle, pensez à eux. La dernière lettre de Verlaine à Rimbaud est
datée d'un 12 décembre - 1875, mais les années ne m'intéressent pas ; c'est
également un 12 décembre que Jean Cassou est mis au secret - en 1941, mais
les années... Ne cherchez pas forcément de points communs entre ces évènements
car il ne semble pas y en avoir. Seul notre bon vieux Max, grand connaisseur
et magicien des dates, aurait su découvrir d'éventuels rapprochements. Mais
Max n'est plus, tout comme George, Alfred et les autres. Pensez à eux. Arrivés
à Lyon, les deux amants descendent le Rhône en compagnie de Stendhal. Diane
Kurys s'en passe et elle a bien raison car il n'a pas d'importance. L'arrivée
à Venise est juste mais le reste du séjour l'est déjà moins, notamment cette
surprenante prise d'opium. Musset touche certainement çà et là à l'opium,
mais à Venise, sa crise de délire et de fièvre a une cause bien différente
: tout au long de sa vie, il est effectivement la victime de crises de démences
dûes semble-t-il à une syphillis contractée précocément, à l'adolescence.
Car ce film nous le fait bien comprendre, Musset est un grand amateur de
maisons closes, dans lesquelles il va d'ailleurs toujours "en équipe", avec
le critique et néanmoins attentionné Sainte-Beuve par exemple, qu'il a initié
lui-même à ces plaisirs un 2 janvier. Ces crises ont une place capitale
dans la vie de Musset. Il en souffre beaucoup. Dans ce contexte, la venue
de l'opium me semble bien inexplicable. Cet artifice mis de côté, la veille
de George auprès de Musset est émouvante et juste. Rien à dire sur le docteur
Pagello : il est docteur et italien ! Cependant, je reste rêveur lorsque
Diane Kurys nous présente innocemment George Sand être la victime de Pagello
- après qu'elle a d'ailleurs été la victime du léger Musset. D'une part,
Musset n'est pas responsable de sa crise de démence, et d'autre part, George
Sand obtient le docteur Pagello parce qu'elle le veut. Quant au départ de
Musset pour Paris, la réalisatrice nous en offre une version à mon sens
un peu trop tendre. Elle oublie les injures : " Tu es bon à enfermer dans
un asile ", dit George à Musset qui répond par " sale putain ". Elle oublie
également les poursuites - poignard à la main - dans le cimetière juif de
l'îlot Saint-Blaise. Diane Kurys les veut toujours tendres et doux. Ils
sont parfois violents. En attendant le retour de George, au printemps 1834,
Musset écrit " On ne badine pas avec l'amour " qui est publié en juillet
suivant. Lisez et relisez ce chef d'œuvre, et pensez à eux. George rentre
le 14 août. Ils se revoient le 17. C'est là que vient un détail essentiel
qui a hélas été évité par la réalisatrice : le 19, Musset demande à George
de la rencontrer au Père-Lachaise, sur la tombe de son père. Tel est par
moment le romantisme de Musset, passionnément macabre. Les cendres de feu
son père échappent cependant à leur visite. Viennent ensuite des retrouvailles
et des séparations sans fin : ils se séparent le 23 août, se revoient le
20 octobre, rompent le 9 novembre - grande date que ce 9 novembre ! C'est
à ce moment précis que viennent les cheveux coupés : dans le film, ils prennent
tout au plus la forme d'une anecdote dont on ne comprend pas bien le sens,
alors qu'ils ont en réalité la dimension d'une des plus grandes légendes
romantiques. Ils sont les cheveux coupés que l'histoire du romantisme devrait
retenir, comme elle retient Jakob Michael Lenz tombant à genoux et pleurant
d'extase sur les bords du Rhin. George fait plus que se couper les cheveux
: elle se les tond puis les envoie, protégés dans la cage cervicale d'un
crâne humain, à son amant. Tel est le romantisme de George qui émeut d'ailleurs
fugitivement Musset : ils se raccomodent trois jours puis se séparent à
nouveau. Ils se retrouvent le 2 janvier suivant (" je ne t'aime plus mais
je t'adore toujours " lui écrit-elle alors) et assistent à une représentation
de Chatterton à la Comédie française, le 14 février. Musset ressort un poignard
le 22 février - jour de l'arrestation de notre bon vieux Max, mais cela
est sans aucun rapport - puis ils se voient pour la dernière fois le 6 mars
- c'est à dire le jour où Ronsard est tonsuré mais cela n'a encore aucun
rapport. Les derniers mots de la dernière lettre de George à Musset sont
" Adieu mon enfant, que Dieu soit avec toi ". A l'avenir, toutes sortes
de gens, de plaisirs et d'abus entoureront Musset, et peut-être même Dieu,
un Dieu de passage alors, mais plus jamais George Sand. Il ne se reverront
plus. La fin du film est d'une consistance étrange. Leur amour y est faussement
romancé. Lorsque Musset décède, plus de vingt ans après, au 6 de la rue
du Mont Thabor, un 2 mai - de l'année 1857, mais vous n'ignorez plus que
les années m'indiffèrent - George Sand est loin de lui, et même très loin.
George Sand ne fait pas partie des trente ombres du cortège. Pensez à eux.
Pensez à elle. Pensez à lui. Il faut croire qu'on ne se coupe les cheveux
qu'une seule fois dans sa vie.
Si
vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir Les Enfants du Siècle, le film
de Diane Kurys qui raconte la liaison entre Alfred de Musset et George Sand.
Déjà, parce qu'il est globalement juste et très bien interprété, et ensuite
parce que les amis de la poésie ne peuvent manquer de voir un film où apparaît
Alfred de Musset - je vous demande de me pardonner cette injonction. Je
veux simplement ici faire quelques commentaires concernant, d'une part,
les deux personnages, tels qu'a voulu nous les montrer la réalisatrice,
et d'autre part, les approximations et omissions volontaires qui ont hélas
simplifié la réalité des choses. Un film n'est cependant pas un documentaire
me direz-vous, ce dont je conviens volontiers, mais dans le cas présent
les choses ont été autrement plus étonnantes et riches que ce que nous laisse
croire Diane Kurys. Dans mon esprit, les lignes qui suivent ne constituent
pas une critique négative de ce film qui m'a emporté de la première minute
à la dernière. Je comprends d'ailleurs que des exigences liées au scénario
puissent m'échapper. Cependant, je voudrais saisir le prétexte qui se présente
pour écrire quelques lignes sur ce qui est effectivement une des histoires
amoureuses et poétiques les plus étincelantes. Je voudrais écrire ici quelques
lignes du scénario d'un documentaire imaginaire qui permettront peut-être,
à ceux qui ont vu le film, de mieux en comprendre les non-dits et les allusions,
et à ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller le voir avec un regard "averti".
Commençons par la rencontre. George Sand et Alfred de Musset ne se voient
pas pour la première fois dans un vague cocktail mais autour d'une table,
au cours d'un repas organisé par Buloz, le directeur de la Revue des deux
Mondes - personnage d'ailleurs très justement rendu dans le film. Détail
symbolique et émouvant, Sand et Musset sont voisins parce que Sand est la
seule femme de l'assemblée et parce que Musset, alors âgé de 22 ans, est
le plus jeune. Si, par hasard, vous passez un 17 juin au 104 de la rue Richelieu,
pensez à eux. C'était l'année 1833, celle de la rencontre entre Juliette
Drouet et son "Toto adoré", mais les années ne m'intéressent pas. Leur liaison
naît au milieu d'une fête populaire, dans les tous derniers jours du mois
de juillet, pour le troisième anniversaire de la Révolution de Juillet.
J'ai regretté de ne pas voir quelques feux d'artifices et de ne pas entendre
ces vers que Musset écrit à Georges Sand le jeudi 2 août, au soir : "Te
voilà revenu dans mes nuits étoilées, Bel ange aux yeux d'azur, aux paupières
voilées, Amour, mon bien suprême, et que j'avais perdu..." C'est effectivement
à Fontainebleau, début août, que les deux amants cèlent plus fermement leur
union. Le décor de grands rochers gréseux - avec coucher de soleil - ainsi
que les promenades à cheval y font subtilement allusion. Deux choses manquent
cependant ici. Deux choses qui auraient sans doute montré George Sand plus
proche de la réalité : d'une part, elle doit annuler une première escapade
avec un italien de ses amants pour partir une semaine avec Musset, et d'autre
part, elle est tantôt amazone tantôt homme au cours de ce séjour. Si George
Sand est indéniablement amoureuse de Musset, elle dévore quantité d'hommes
partout où elle passe : avant, pendant, après Musset, elle a des amants
nombreux. Diane Kurys nous présente Musset quittant la chaleur d'une maison
close pour aller se recueillir aussitôt dans les bras de George Sand quand
ses " hésitations " à elles sont fâcheusement oubliées. Or, George Sand
n'est à aucun moment la victime de Musset, que ce soit à Paris ou à Venise.
George Sand est certes sensible et douce mais elle est une femme de caractère.
Elle est forte maîtresse. Quant à l'ambiguité sexuelle de George Sand, qui
est un élement essentiel de sa vie, l'est également dans sa relation avec
Musset : ne la nomme-t-il pas, dans la plupart de ses lettres : "Mon George"...
Le départ pour Venise est très justement rendu, notamment l'entrevue qui
réunit George Sand et la mère de Musset. Il est exact que George Sand promet
à cette femme de s'occuper de son fils et de le protéger. D'ailleurs, elle
rappelle souvent à Musset qu'elle l'aime comme son enfant ; quant à lui,
par une heureuse réciprocité, il lui dit fréquemment qu'il l'aime comme
une mère. Si d'aventure vous passez un 12 décembre devant le 59 de la rue
de Grenelle, pensez à eux. La dernière lettre de Verlaine à Rimbaud est
datée d'un 12 décembre - 1875, mais les années ne m'intéressent pas ; c'est
également un 12 décembre que Jean Cassou est mis au secret - en 1941, mais
les années... Ne cherchez pas forcément de points communs entre ces évènements
car il ne semble pas y en avoir. Seul notre bon vieux Max, grand connaisseur
et magicien des dates, aurait su découvrir d'éventuels rapprochements. Mais
Max n'est plus, tout comme George, Alfred et les autres. Pensez à eux. Arrivés
à Lyon, les deux amants descendent le Rhône en compagnie de Stendhal. Diane
Kurys s'en passe et elle a bien raison car il n'a pas d'importance. L'arrivée
à Venise est juste mais le reste du séjour l'est déjà moins, notamment cette
surprenante prise d'opium. Musset touche certainement çà et là à l'opium,
mais à Venise, sa crise de délire et de fièvre a une cause bien différente
: tout au long de sa vie, il est effectivement la victime de crises de démences
dûes semble-t-il à une syphillis contractée précocément, à l'adolescence.
Car ce film nous le fait bien comprendre, Musset est un grand amateur de
maisons closes, dans lesquelles il va d'ailleurs toujours "en équipe", avec
le critique et néanmoins attentionné Sainte-Beuve par exemple, qu'il a initié
lui-même à ces plaisirs un 2 janvier. Ces crises ont une place capitale
dans la vie de Musset. Il en souffre beaucoup. Dans ce contexte, la venue
de l'opium me semble bien inexplicable. Cet artifice mis de côté, la veille
de George auprès de Musset est émouvante et juste. Rien à dire sur le docteur
Pagello : il est docteur et italien ! Cependant, je reste rêveur lorsque
Diane Kurys nous présente innocemment George Sand être la victime de Pagello
- après qu'elle a d'ailleurs été la victime du léger Musset. D'une part,
Musset n'est pas responsable de sa crise de démence, et d'autre part, George
Sand obtient le docteur Pagello parce qu'elle le veut. Quant au départ de
Musset pour Paris, la réalisatrice nous en offre une version à mon sens
un peu trop tendre. Elle oublie les injures : " Tu es bon à enfermer dans
un asile ", dit George à Musset qui répond par " sale putain ". Elle oublie
également les poursuites - poignard à la main - dans le cimetière juif de
l'îlot Saint-Blaise. Diane Kurys les veut toujours tendres et doux. Ils
sont parfois violents. En attendant le retour de George, au printemps 1834,
Musset écrit " On ne badine pas avec l'amour " qui est publié en juillet
suivant. Lisez et relisez ce chef d'œuvre, et pensez à eux. George rentre
le 14 août. Ils se revoient le 17. C'est là que vient un détail essentiel
qui a hélas été évité par la réalisatrice : le 19, Musset demande à George
de la rencontrer au Père-Lachaise, sur la tombe de son père. Tel est par
moment le romantisme de Musset, passionnément macabre. Les cendres de feu
son père échappent cependant à leur visite. Viennent ensuite des retrouvailles
et des séparations sans fin : ils se séparent le 23 août, se revoient le
20 octobre, rompent le 9 novembre - grande date que ce 9 novembre ! C'est
à ce moment précis que viennent les cheveux coupés : dans le film, ils prennent
tout au plus la forme d'une anecdote dont on ne comprend pas bien le sens,
alors qu'ils ont en réalité la dimension d'une des plus grandes légendes
romantiques. Ils sont les cheveux coupés que l'histoire du romantisme devrait
retenir, comme elle retient Jakob Michael Lenz tombant à genoux et pleurant
d'extase sur les bords du Rhin. George fait plus que se couper les cheveux
: elle se les tond puis les envoie, protégés dans la cage cervicale d'un
crâne humain, à son amant. Tel est le romantisme de George qui émeut d'ailleurs
fugitivement Musset : ils se raccomodent trois jours puis se séparent à
nouveau. Ils se retrouvent le 2 janvier suivant (" je ne t'aime plus mais
je t'adore toujours " lui écrit-elle alors) et assistent à une représentation
de Chatterton à la Comédie française, le 14 février. Musset ressort un poignard
le 22 février - jour de l'arrestation de notre bon vieux Max, mais cela
est sans aucun rapport - puis ils se voient pour la dernière fois le 6 mars
- c'est à dire le jour où Ronsard est tonsuré mais cela n'a encore aucun
rapport. Les derniers mots de la dernière lettre de George à Musset sont
" Adieu mon enfant, que Dieu soit avec toi ". A l'avenir, toutes sortes
de gens, de plaisirs et d'abus entoureront Musset, et peut-être même Dieu,
un Dieu de passage alors, mais plus jamais George Sand. Il ne se reverront
plus. La fin du film est d'une consistance étrange. Leur amour y est faussement
romancé. Lorsque Musset décède, plus de vingt ans après, au 6 de la rue
du Mont Thabor, un 2 mai - de l'année 1857, mais vous n'ignorez plus que
les années m'indiffèrent - George Sand est loin de lui, et même très loin.
George Sand ne fait pas partie des trente ombres du cortège. Pensez à eux.
Pensez à elle. Pensez à lui. Il faut croire qu'on ne se coupe les cheveux
qu'une seule fois dans sa vie.